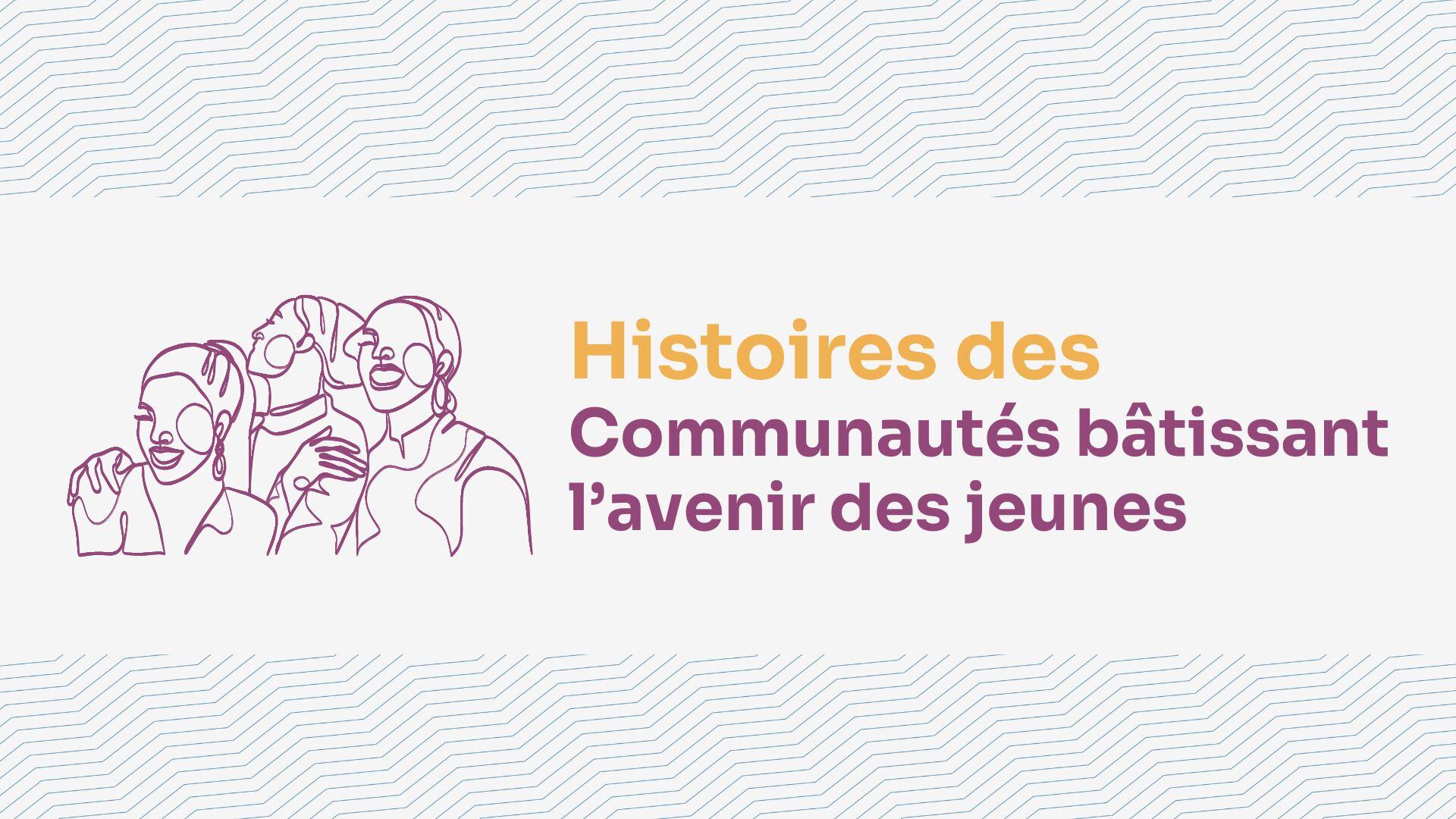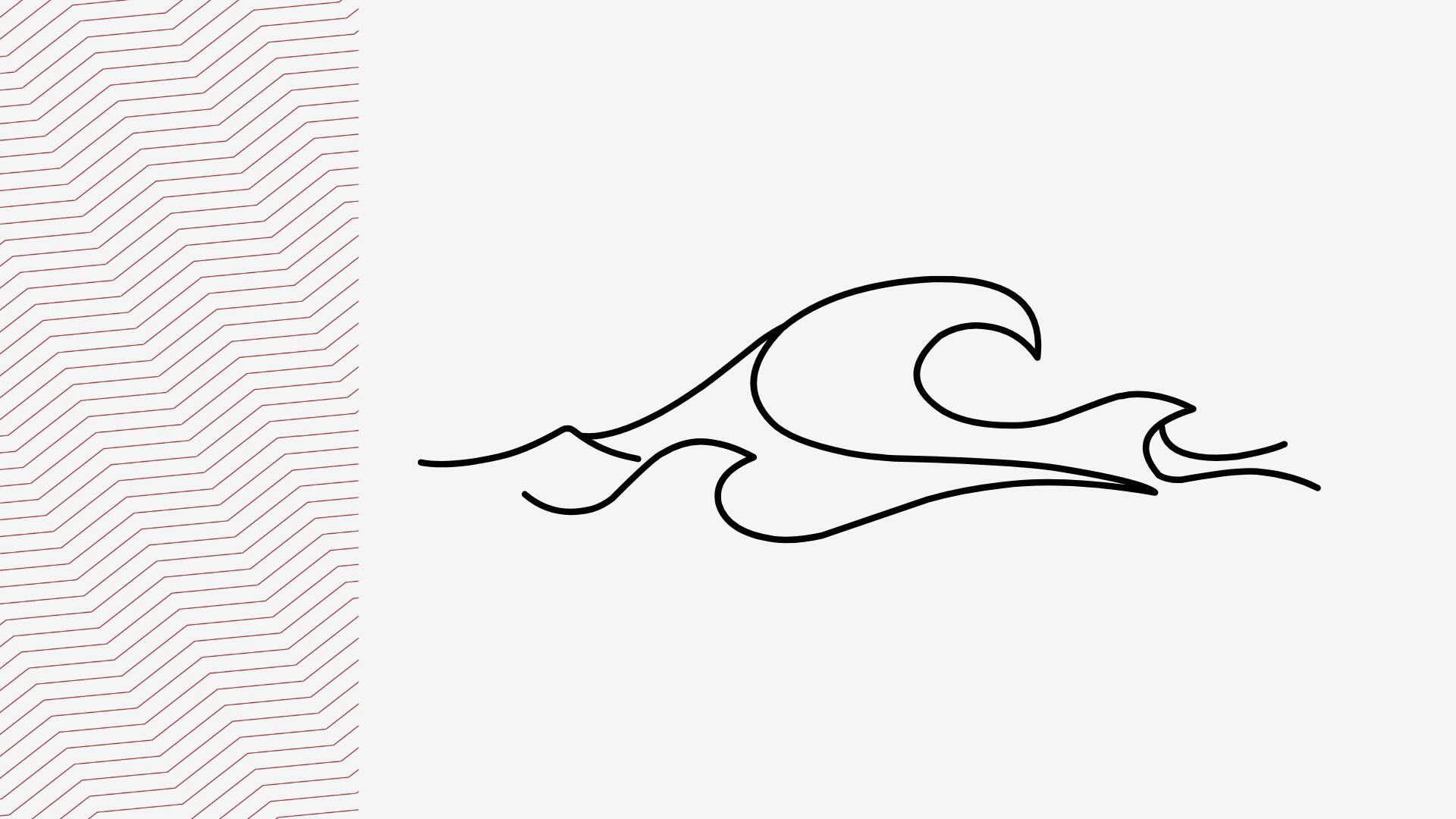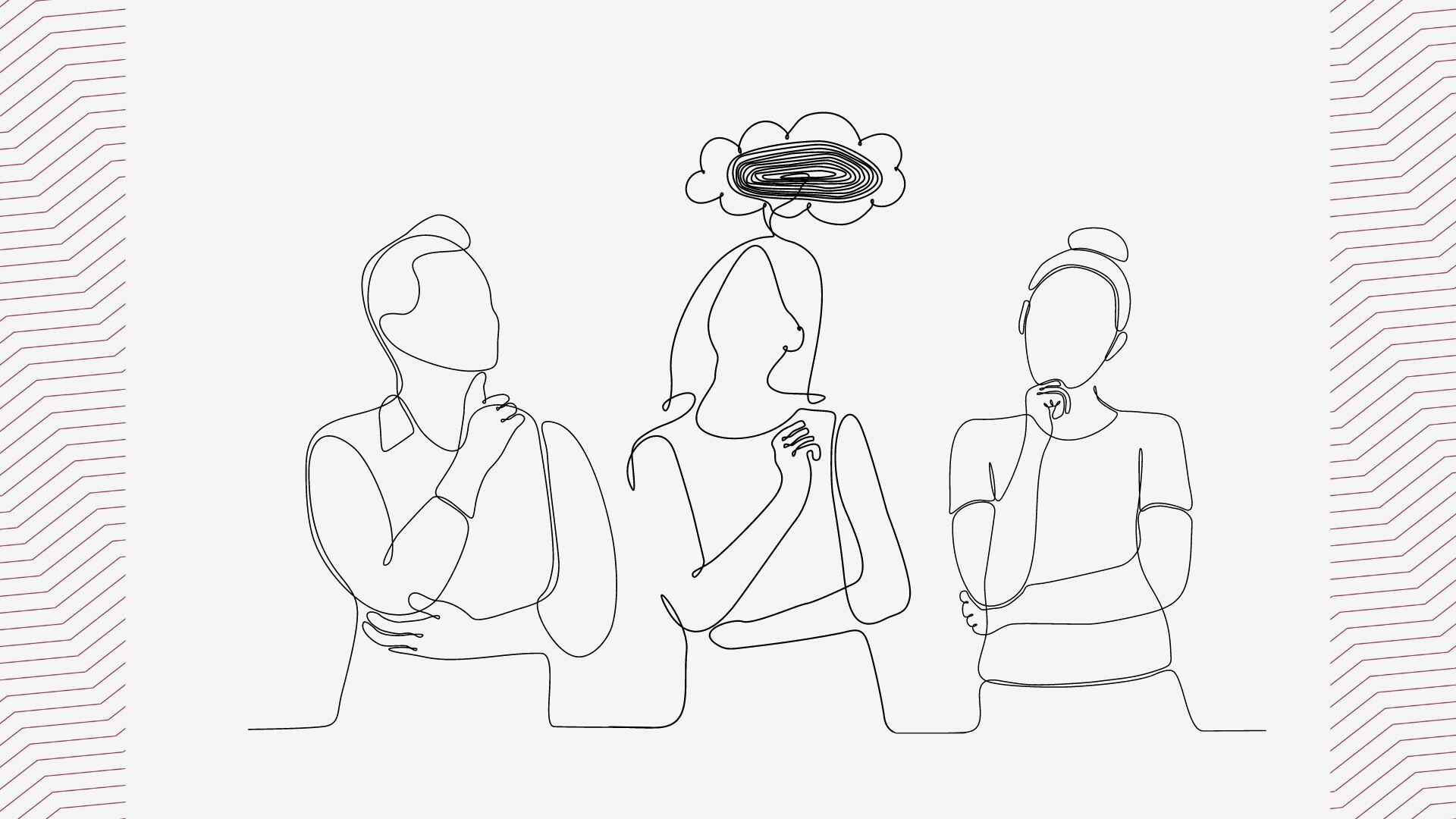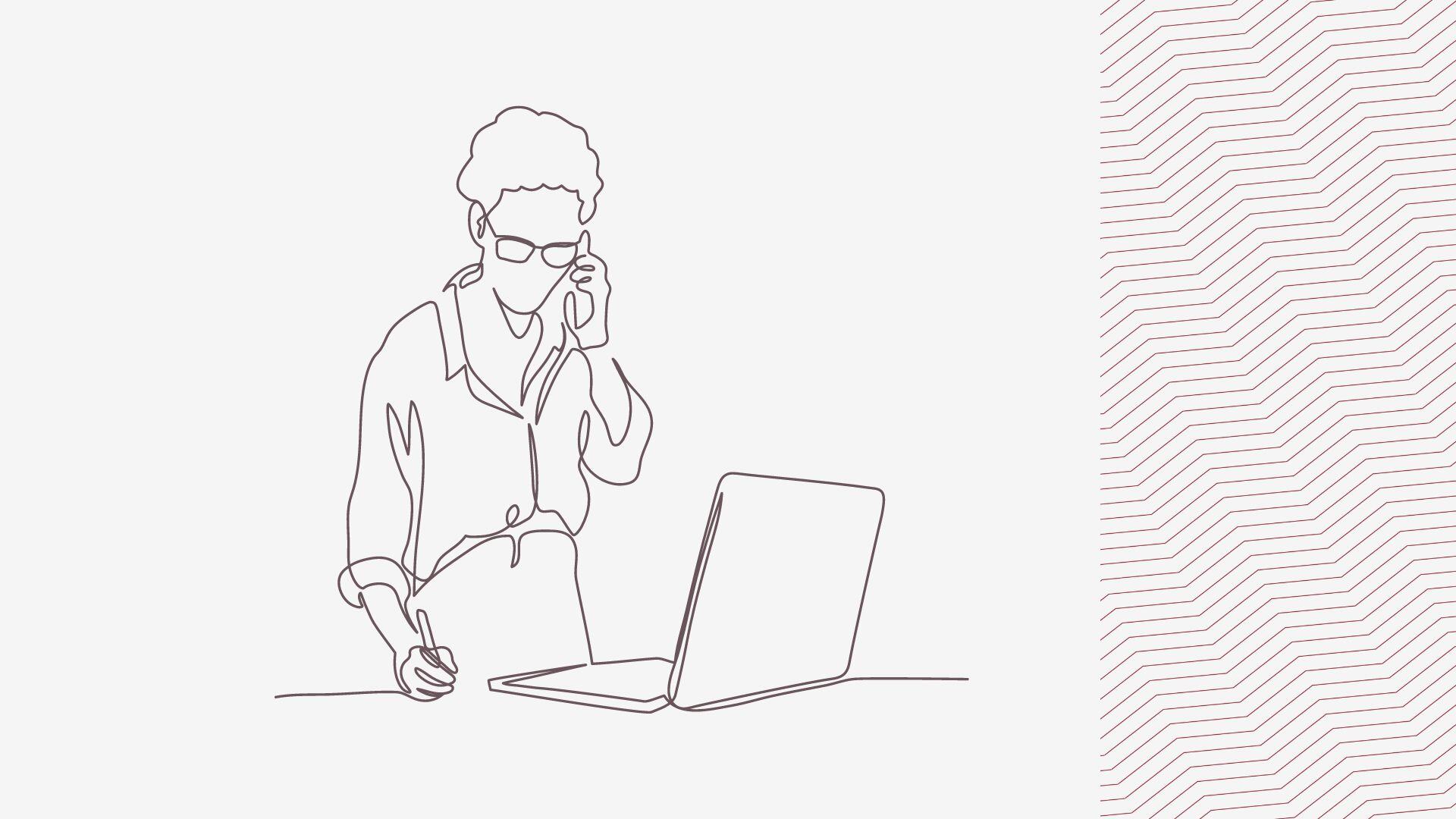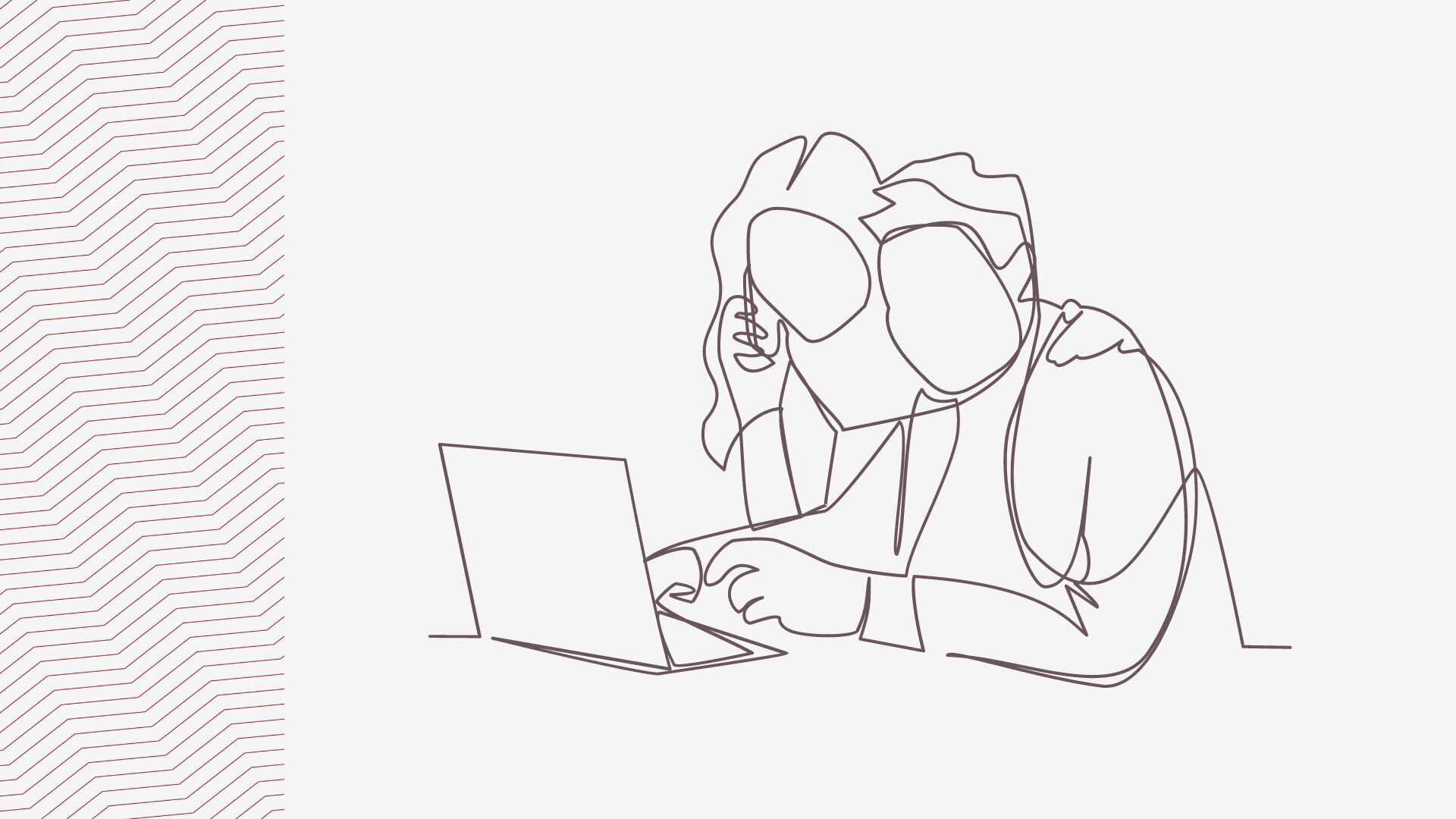collaboration
La collaboration constitue le mot d’ordre renouvelé nécessaire pour créer des solutions à fort impact servant à résoudre les problèmes complexes et interconnectés qui affectent les communautés. Lorsque le leadership et les connaissances de divers secteurs, groupes et individus sont rassemblés, cela libère la créativité et mobilise une action coordonnée plus puissante à l’échelle communautaire, ce qui résulte en plus de justice et d’équité pour tous.


Cours en ligne
impact collectif
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit dictumst vitae ullamcorper ac ac. Tellus non augue fringilla elit egestas volutpat amet, quam. Felis amet interdum gravida ultricies dapibus diam sed mi.
La collaboration est au cœur de l’approche de l'Institut concernant le changement communautaire, mais nous savons que ce n’est pas facile. Travailler efficacement avec les autres, en particulier ceux que nous ne connaissons pas encore, ou en qui nous n’avons pas confiance, exige des compétences et un état d’esprit qui sont différents de ceux mise à l'oeuvre dans le cadre d'une initiative d’une seule organisation ou d’un seul groupe. À l'Institut, vous trouverez les cadres, les outils, les approches et les exemples dont vous avez besoin pour rendre l'initiative collaborative plus simple et plus efficace.
entreprendre une démarche
Le spectre de la collaboration
Rivalité, confiance, cocréation et impact collectif
Impact collectif 3.0
Stakeholder Engagement Wheel

rencontrez la directrice
Sylvia est directrice des services-conseils dans le domaine de la collaboration à l’Institut Tamarack. Elle est passionnée par le changement communautaire et ce qui devient possible lorsque les résident.e.s et les divers dirigeant.e.s du secteur partagent une vision ambitieuse pour leur avenir. En tant que catalyseuse de systèmes, Sylvia s’appuie sur ses connaissances pratiques et son expérience du travail de collaboration multisectorielle et de changement des systèmes.

Thèmes d'actualité :
Il est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de changement des systèmes pour que les acteurs et actrices du changement puissent êtres effectif.ive.s. Ce que nous savons au sujet du changement des systèmes, c’est que :
- Les programmes et services efficaces génèrent rarement les changements transformationnels et durables nécessaires pour aborder de façon significative les questions sociales et/ou environnementales complexes;
- Les stratégies de changement des systèmes se concentrent sur les pratiques et les perspectives désormais institutionnalisées, qui maintiennent involontairement les problèmes en place;
- Les approches de collaboration sont efficaces pour aider à identifier et à éliminer les obstacles du système.
Comment la collaboration stimule l’innovation communautaire
La collaboration multisectorielle stimule l’innovation communautaire en :
- Faisant appel à la sagesse de plusieurs intervenant.e.s — en particulier ceux et celles qui sont les plus proches du problème — pour créer une appréciation plus riche et plus nuancée d’un problème commun;
- Reconnaissant et exploitant les forces et les ressources propres à chaque lieu;
- Exploitant la créativité collective pour co-concevoir de nouvelles solutions;
- S’alignant sur une stratégie unifiée pour mobiliser une action coordonnée à l’échelle de la communauté où le leadership et la responsabilité sont partagés.
Le rôle essentiel – et souvent invisible – des catalyseurs de terrain dans le changement communautaire
Les catalyseurs de terrain accélèrent et amplifient l’impact des efforts de changement des communautés locales en les connectant et en les reliant intentionnellement à des stratégies plus larges de changement de systèmes. Pour ce faire, ils jouent quatre rôles intégrés :
- Comprendre le terrain et impliquer les acteurs et actrices du système;
- Renforcer la capacité des initiatives de changement des communautés locales;
- Rendre le travail des initiatives collaboratives locales plus visibles, cohérentes et solides;
- Interpeler les systèmes afin de catalyser leur transformation.

L'initiative collaborative
Depuis 2011, Tamarack collabore avec des parties prenantes à travers le Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale en tant que co-catalyseur afin de faire progresser la collaboration en tant que cadre de changement communautaire.
L’Institut Tamarack travaille activement avec des collaborateur.rice.s tel.le.s le Collective Impact Forum et le Harwood Institute aux États-Unis, Inspiring Communities en Nouvelle-Zélande et le Collaboration for Impact en Australie pour développer le champ de pratique d’initiatives collaboratives visant le changement communautaire.
événements à venir

1/21/26 1:00 PM EST @ 1:00 PM ET
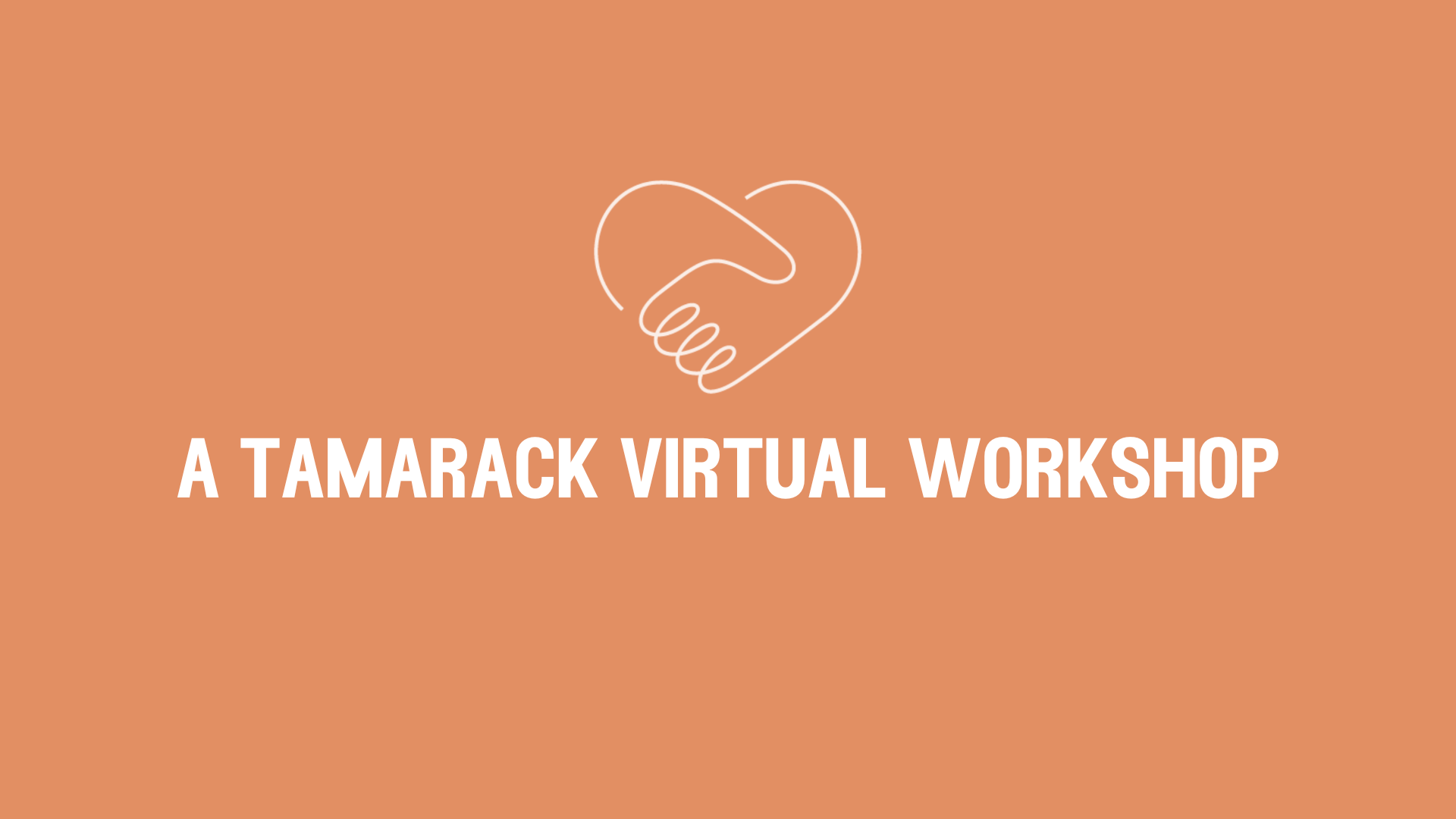
1/22/26 1:00 PM EST @ 1:00 PM ET
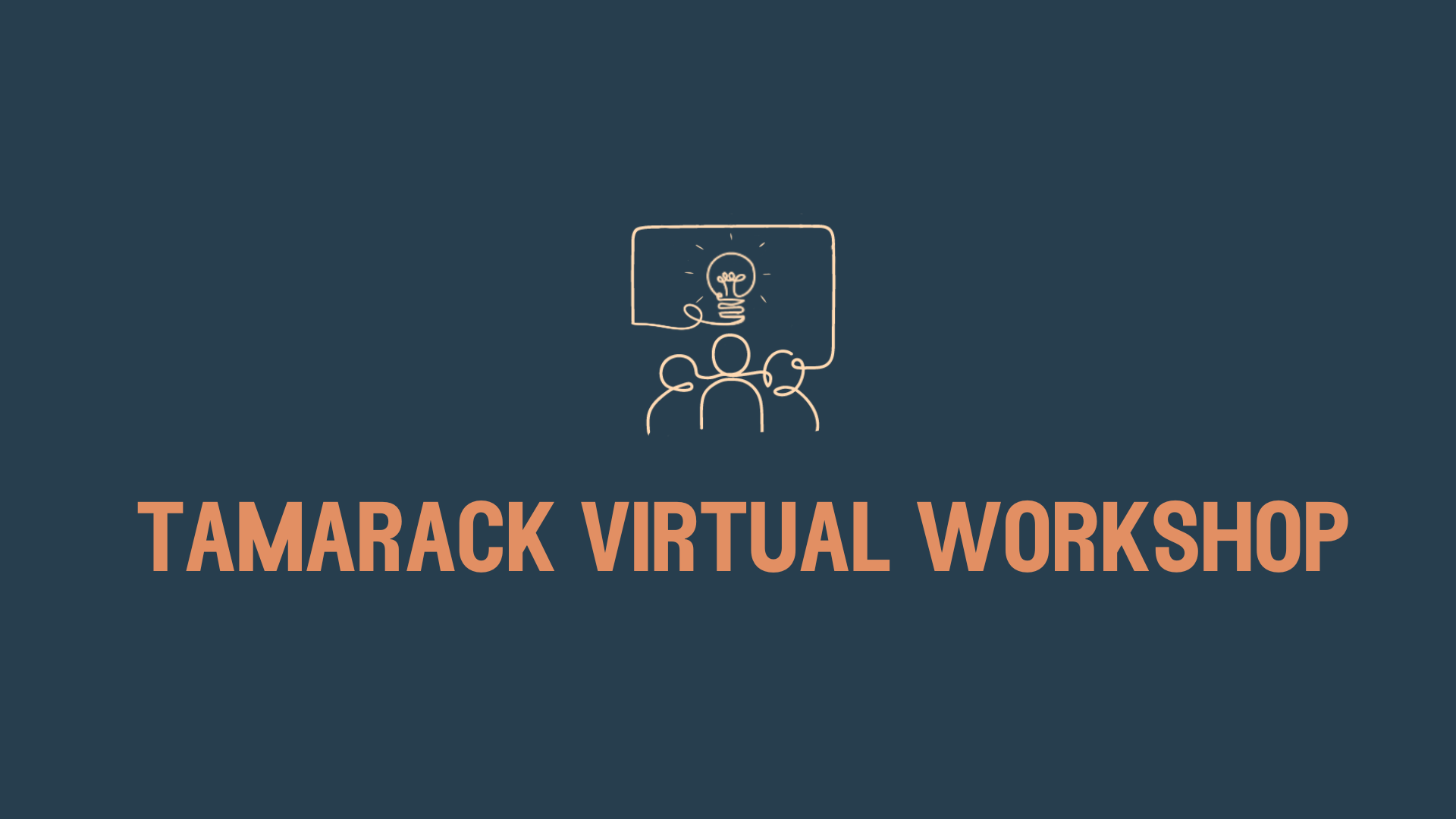
3/5/26 1:00 PM EST @ 1:00 PM ET
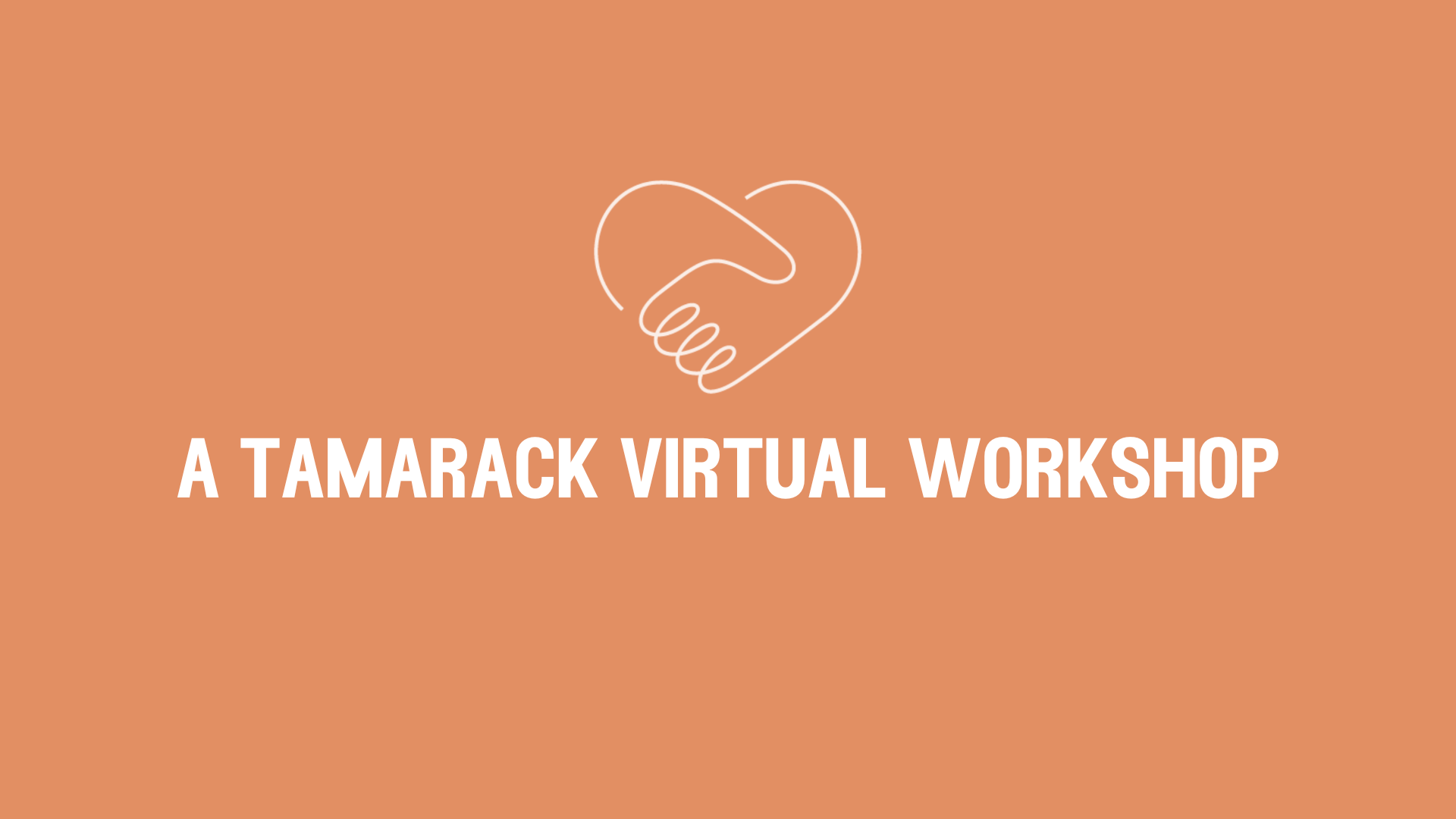
3/26/26 1:00 PM EDT @ 1:00 PM ET
nous joindre
Nous sommes là pour répondre à vos questions et pour discuter des défis de votre communauté pour vous diriger vers des ressources qui peuvent vous aider. Contactez un membre de l’équipe ou soumettez une demande générale.

tenez-vous à jour
Entrez votre courriel et choisissez votre abonnement(s).