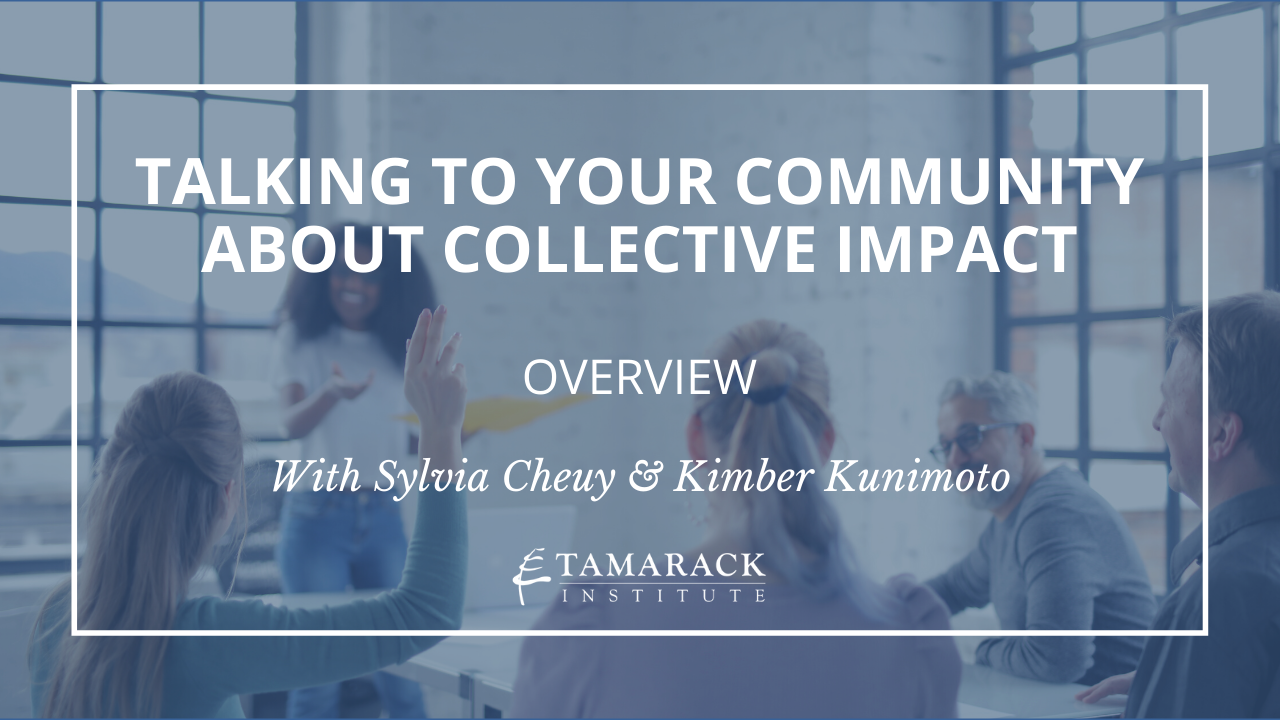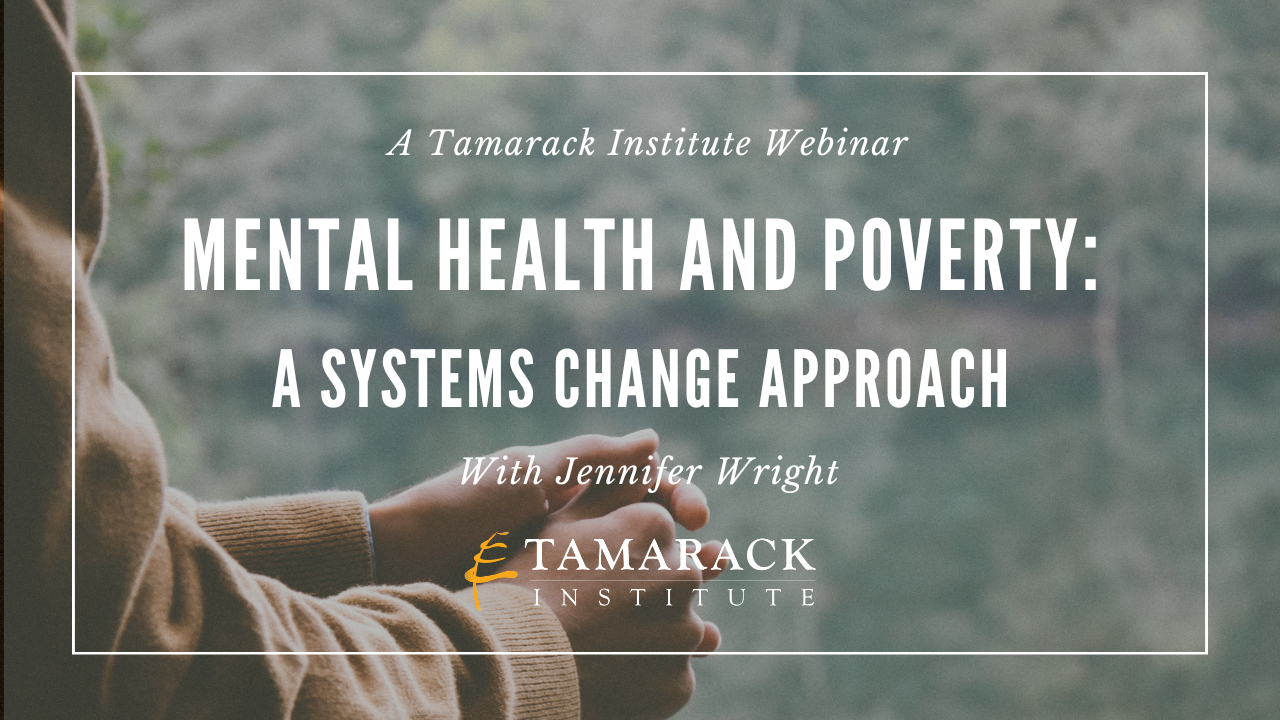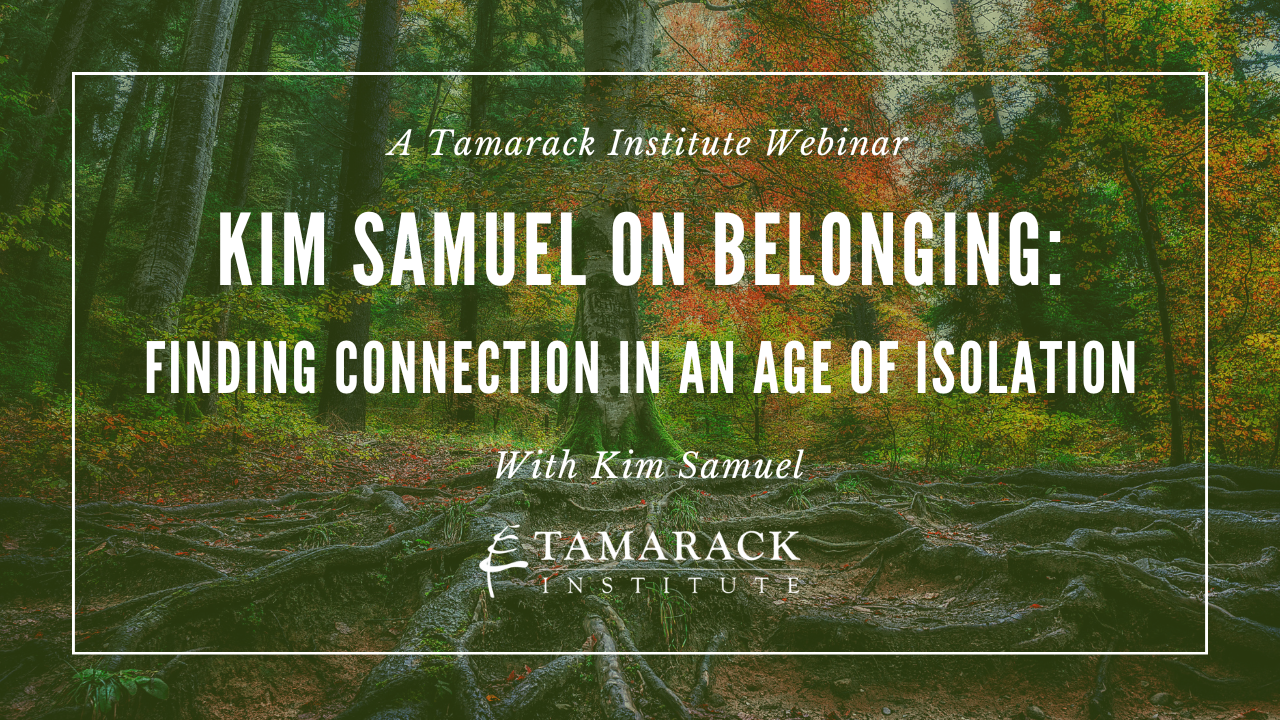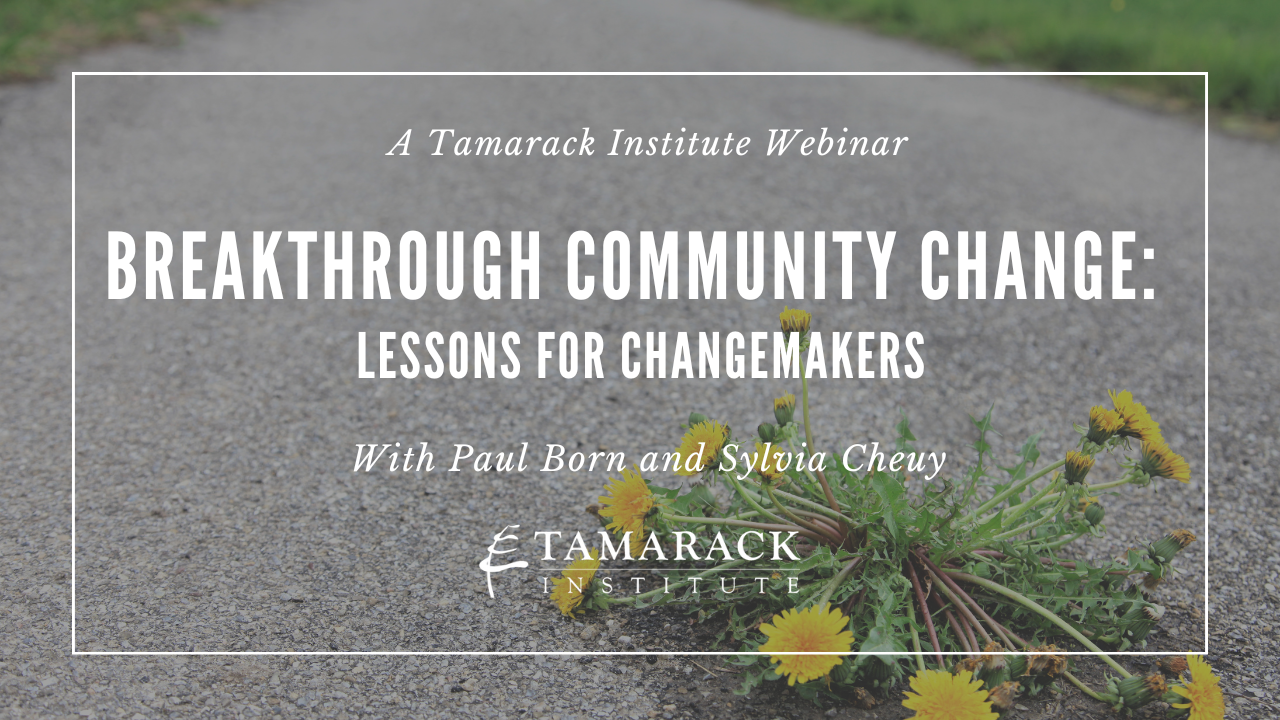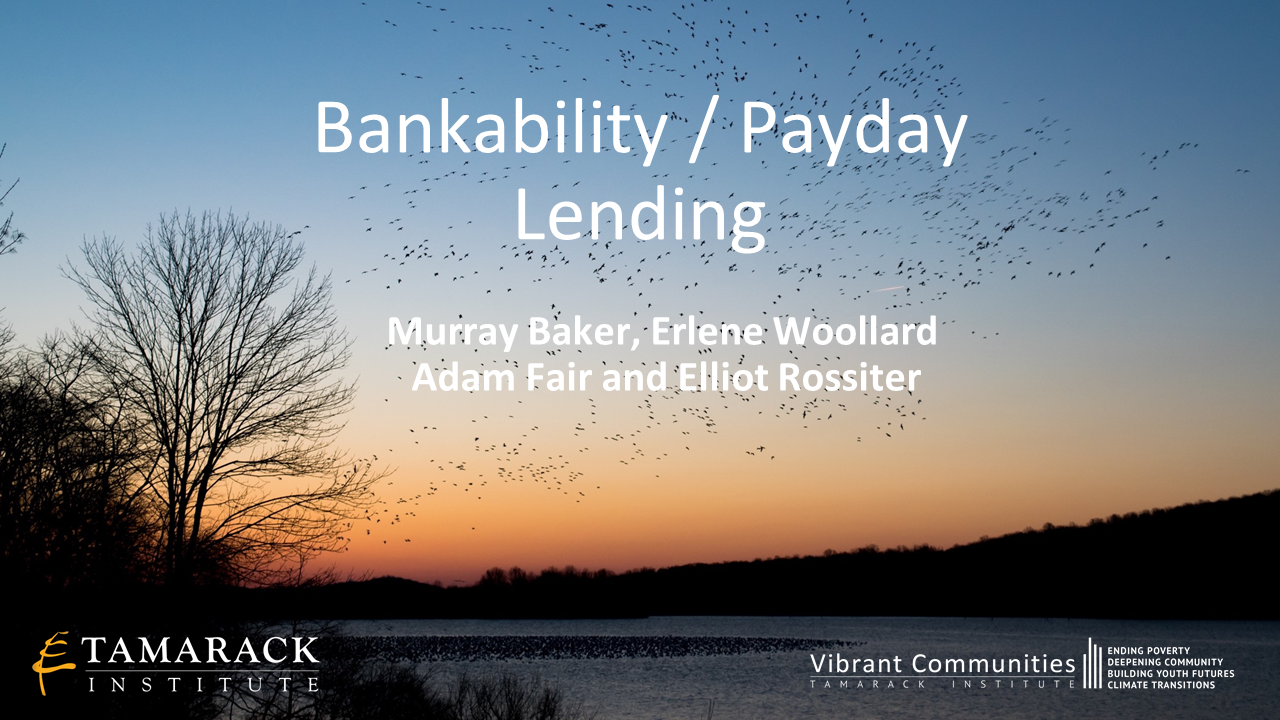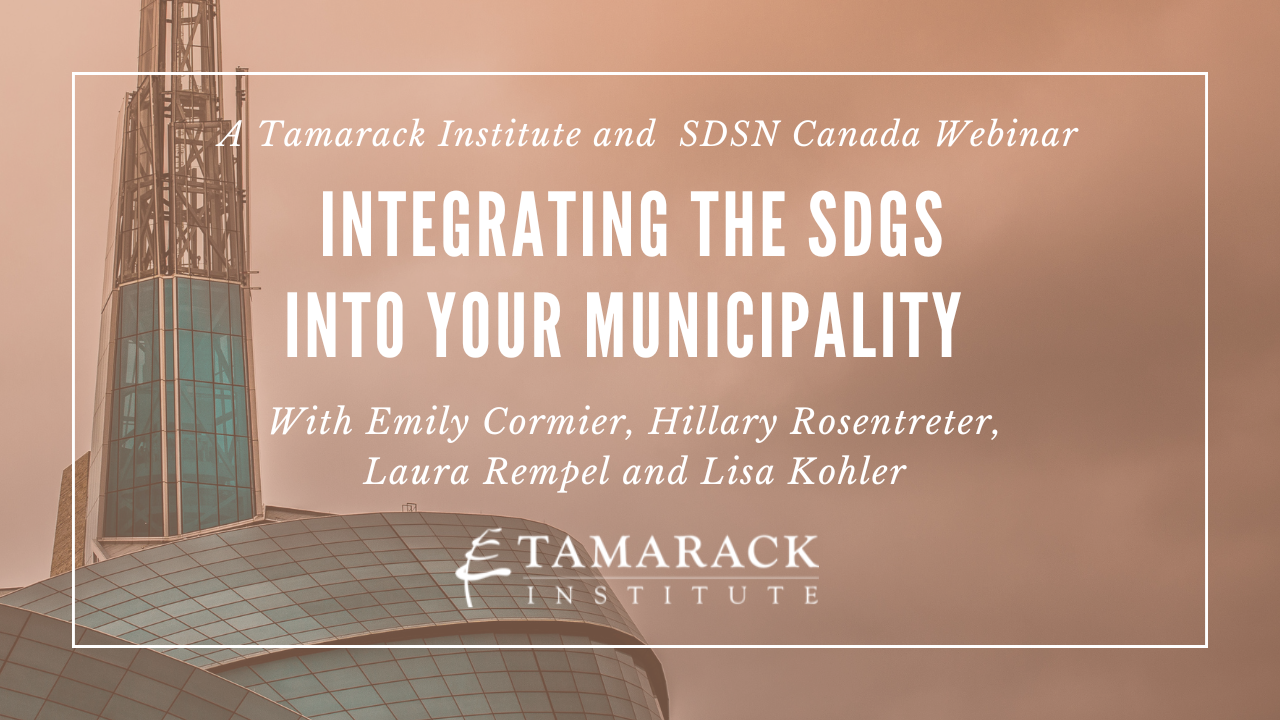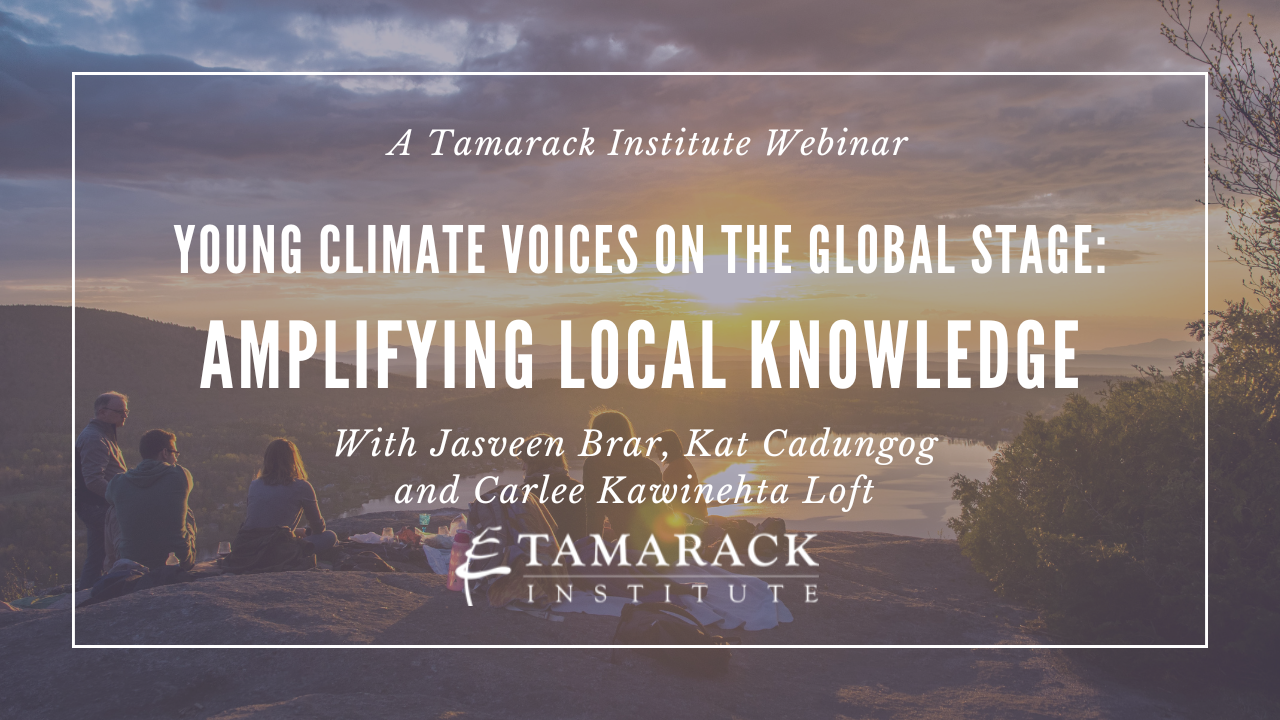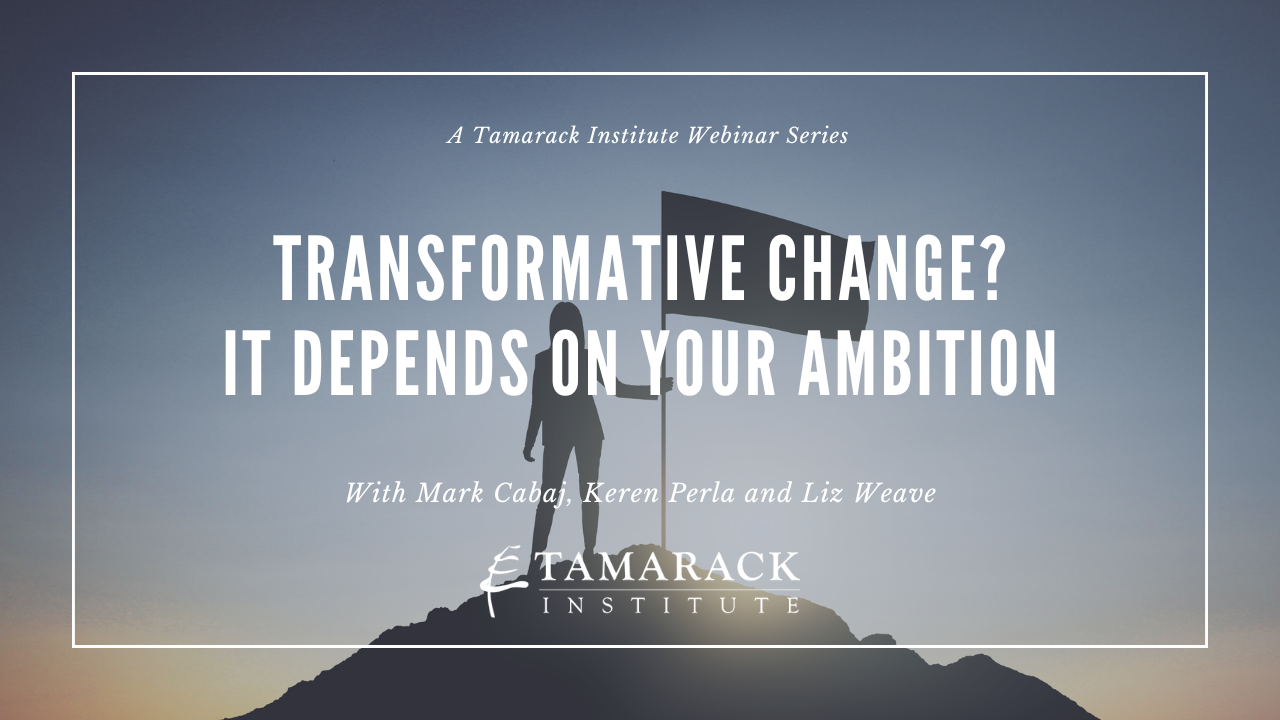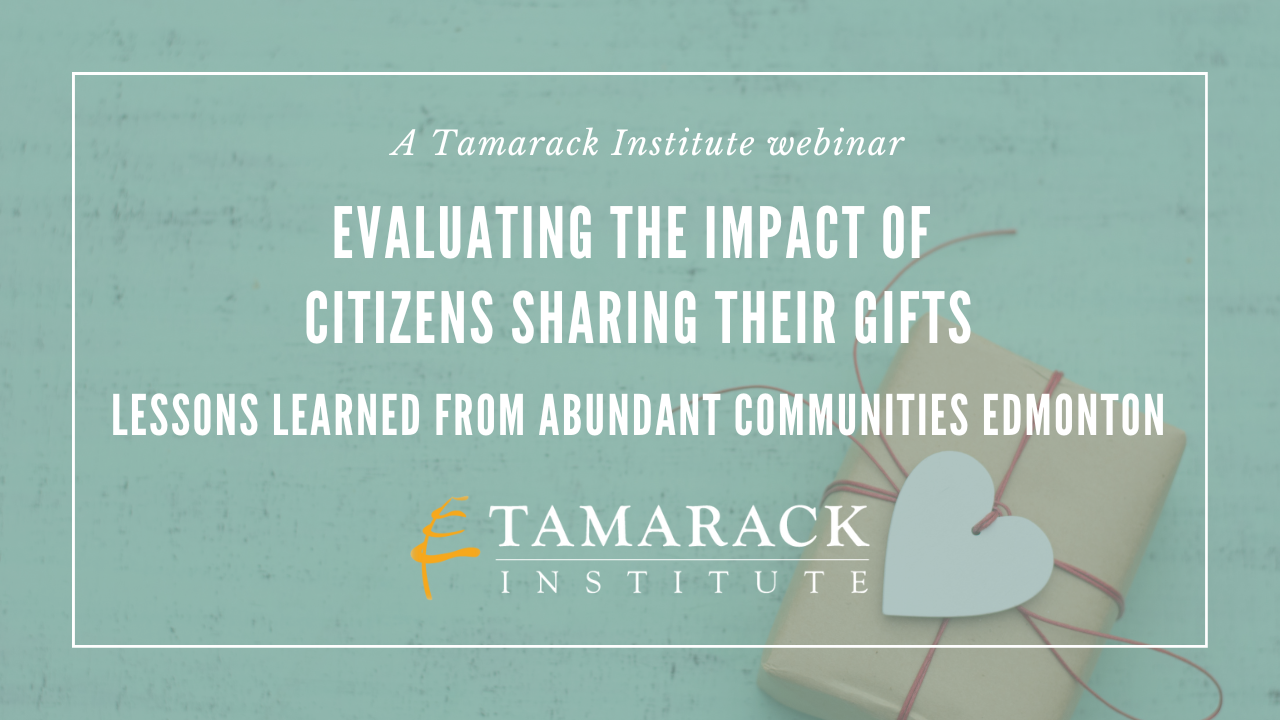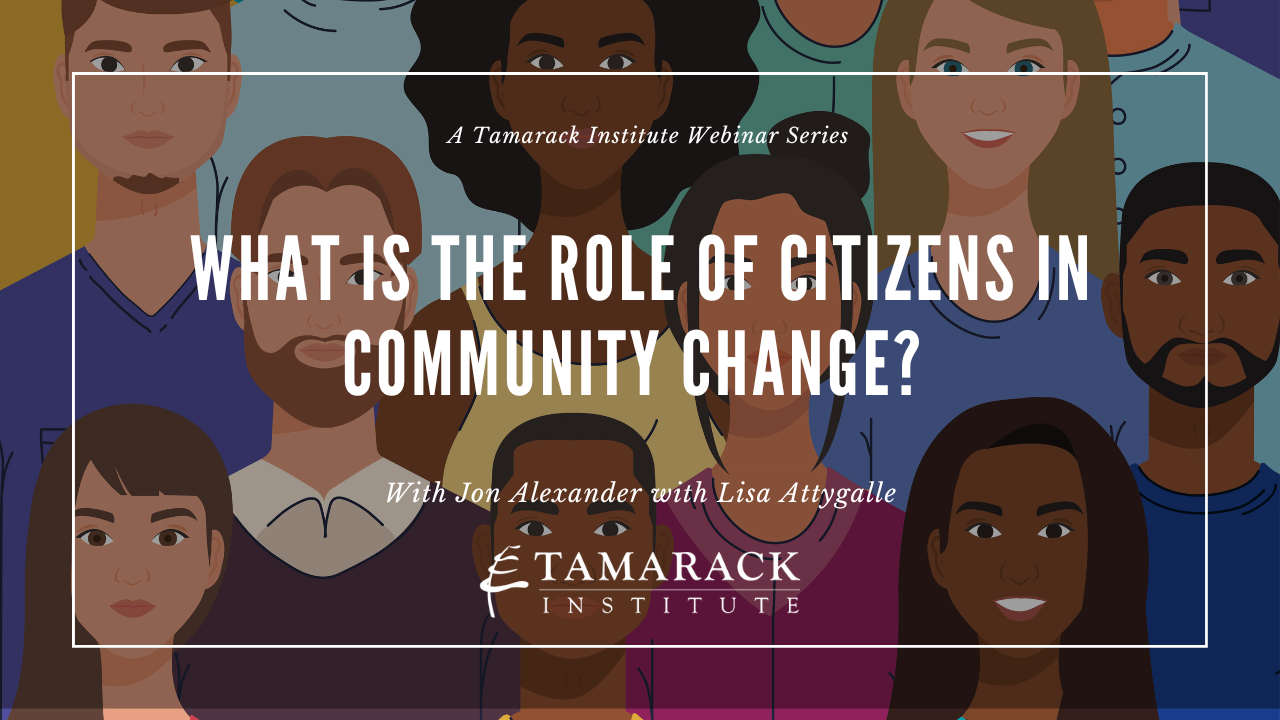Les participant.e.s à Howl posent devant un magnifique paysage du Yukon
Introduction
Le grand territoire du Yukon est l’un des trois territoires du Nord canadien. Il est le plus peuplé parmi les trois avec une population croissante de 45 000 personnes. Le 7 août 2025, je suis arrivé à l’aéroport de Montréal (YUL) avec trois valises et un sac à dos afin de lancer une aventure magnifique. Pour commencer cette histoire, il faut revenir quelques mois en arrière.
Un jour quelconque de mars, j’ai vu une publicité sur Instagram d’un organisme albertain qui s’appelle The Howl Experience (Howl). Selon son site Web, Howl « offre le type d’apprentissage que nous croyons que tout le monde mérite : une éducation qui respecte l’individualité, la culture et l’énergie propres à chaque personne ». Par curiosité, j’ai regardé les programmes offerts sur le site Web et j’ai vu un voyage au Yukon pour les jeunes personnes ayant moins de 35 ans. Tout de suite, j’étais pris. Voici la description du programme que j’ai lu :
Collaborez avec des Aîné·e·s locaux·ales, des détenteur·rice·s du savoir, des gardien·ne·s de la langue, des artistes et des chercheur·se·s pour approfondir votre compréhension des systèmes de savoirs autochtones, des changements climatiques, de la RéconciliAction, du développement communautaire et de la résilience personnelle. Laissez-vous inspirer et trouvez votre voix (ou votre hurlement?) en vous connectant véritablement au lieu grâce à un apprentissage ancré dans la terre et la communauté, le tout dans une approche fondée sur les relations et l’approche à double perspective.
Qui peut résister à une telle programmation? En tant qu’employé à l’Institut Tamarack, je suis très chanceux de disposer d’un budget de développement professionnel et d’avoir une direction qui soutient la formation continue. Dès que j’ai reçu l’approbation de poursuivre cette occasion d’apprentissage, j’ai soumis ma candidature.
À l’Institut Tamarack, je suis le directeur-conseil de l’évaluation de l’impact dans l’équipe du Centre d’apprentissage. Mon rôle est de soutenir les communautés en catalysant les changements systémiques qu’elles souhaitent voir chez elles afin d’améliorer notre société pour tou·te·s. Par conséquent, j’ai la responsabilité de faire de mon mieux pour avoir accès aux meilleurs savoirs possibles afin de pouvoir être le catalyseur à la hauteur des attentes et des besoins des communautés que nous servons. C’est un honneur que les communautés à travers le pays m’accueillent chez elles pour prendre part à des conversations importantes (ou même pour les mener) concernant leurs avenirs. C’est une responsabilité et c’est un honneur que je prends très au sérieux.
À travers cette occasion d’apprentissage, je peux : apprendre de la terre (l’apprentissage local, une valeur importante à l’Institut Tamarack); apprendre des Aîné·e·s autochtones (réconciliation et autochtonisation, des objectifs très importants à l’Institut Tamarack); et apprendre de spécialistes sur des sujets importants, tels que les répercussions des changements climatiques et la résilience. En plus, sur le plan personnel, j’ai pu visiter un territoire qui a toujours attisé ma curiosité et, en tant que francophone issu du milieu minoritaire, j’ai pu visiter la région la plus bilingue (anglais-français) au Canada après le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Alors, on revient à l’histoire. Je suis arrivé à l’aéroport de Montréal, prêt à commencer mon déplacement vers le Grand Nord. J’ai pris trois vols : de Montréal à Edmonton, d’Edmonton à Vancouver et, finalement, de Vancouver à Whitehorse (YXY). Lors de mon vol de Vancouver à Whitehorse, j’ai vu des montagnes magnifiques avec des glaciers, des lacs dans des bols montagneux et des paysages éblouissants. L’atterrissage était un moment éclatant. Me voilà, enfin, dans le Yukon. Même pas deux minutes dans le territoire et je peux confirmer que son slogan « Plus grand que nature » est, en effet, très exact.

Un magnifique paysage du Yukon avec un lac et des montagnes
Un membre du personnel de Howl m’a cherché à l’aéroport (merci beaucoup Mackenzy!) et c’était enfin le début de l’aventure.
Il y avait 19 jeunes personnes qui ont été sélectionnées pour cette pérégrination. Quelques Britanno-Colombien·ne·s, plusieurs Albertain·e·s et Ontarien·ne·s et deux personnes des Maritimes. On compte dans notre groupe plusieurs personnes autochtones, quelques personnes immigrantes, un francophone (moi), des personnes queers, des personnes neurodivergentes, des ados à l’école secondaire, des professionnel·le·s, des mères célibataires, des membres des Forces armées canadiennes… parmi d’autres identités. C’était un groupe diversifié ayant des perspectives du monde différentes, des raisons d’être au Yukon différentes et des compétences différentes. Cependant, on était tou·te·s de jeunes personnes en quête de connaissances.
Leçon no 1 : le #LandBack est possible et c’est beau
Notre apprentissage a commencé à l’Université du Yukon (YukonU), la première (et la seule) université dans le Nord canadien. Notre groupe a été reçu par Jedrek Dendys et Temira Vance, deux professeur·e·s autochtones à la YukonU, qui nous ont appris des histoires de toutes les nations autochtones qui se trouvent dans le territoire qu’on appelle actuellement le Yukon. Ces professeur·e·s ont parlé non seulement de la résilience, mais également de l’organisation politique des nations pour pouvoir négocier les traités modernes qui ont rendu le Yukon très unique à l’échelle mondiale dans sa gouvernance.
Ici, on compte 14 Premières Nations, dont 11 ont conclu des traités modernes leur conférant le pouvoir de légiférer et de prendre des décisions à l’égard de leurs citoyen·ne·s et des terres visées par un règlement. En résumé, nous avons parlé du #LandBack, ce mouvement visant à retourner les terres aux peuples autochtones, ainsi que de la décolonisation, qui cherche à réduire (voire à éliminer) le pouvoir colonial.
Nous avons appris que le Yukon est un chef de file dans ces deux démarches et que le #LandBack est bel et bien possible. Dans ces territoires réappropriés, on voit cohabiter au quotidien des personnes allochtones, immigrantes et autochtones. Ce n’est pas « la fin du monde », comme certain·e·s aimeraient le croire dans le Sud canadien. Aucune personne n’a été « renvoyée » nulle part. Les propriétaires conservent leurs maisons, tout en versant désormais une partie de leurs impôts fonciers à la Première Nation à qui appartiennent ces terres. C’était magnifique à voir.
Imaginez à quel point le fardeau individuel s’allège lorsque le système reconnaît la légitimité des Premières Nations : ainsi, ce n’est plus à chaque personne de trouver seule comment agir. On peut continuer à vivre son quotidien tout en participant à la décolonisation — et ce, sans efforts supplémentaires.
Leçon no 2 : l’importance de l’innovation communautaire
Nous sommes allé·e·s nous installer au centre de recherche Kluane Lake. C’était notre base d’action, notre noyau pour commencer chaque jour de notre aventure et revenir nous rétablir à la fin de chaque journée. Après avoir pris le temps de s’installer (défaire les valises, manger et s’orienter), on a commencé par un tour de Silver City par la descendante d’une de ses résident·e·s, Pauly Sias. Par suite de l’histoire autochtone de la terre, Silver City est devenue une ville abandonnée à l’ouest du Yukon avec des récits riches allochtones, remplis d’aventurier·ère·s qui cherchaient de l’or, qui travaillaient pour bâtir l’autoroute vers l’Alaska et/ou qui fuyaient l’abattement de la vie.
Pauly fait partie de la Première Nation Kluane. Elle porte à la fois l’ascendance autochtone du côté de sa mère et l’ascendance allochtone du côté de son père. Elle nous a raconté des histoires de survie des deux côtés de sa famille. Pauly a parlé de la difficulté de vivre à cette époque et des outils ainsi que des innovations que les personnes ont conçues pour répondre à leurs besoins et suivre des pratiques culturelles. Elle nous a montré des roches qui ont été façonnées pour tanner des peaux et le processus laborieux qui nécessitait beaucoup de muscles pour y arriver. Elle a partagé des os sculptés comme outils pour boire de la soupe ou même tailler du bois. Elle nous a montré les maisons abandonnées à Silver City, le manque de luxure et le besoin de communauté pour créer la vitalité. Bref, elle a parlé de l’innovation.
Ce qui m’a vraiment marqué dans ses récits, c’est qu’elle a brisé la fausse tension qui existe parfois entre les traditions et l’innovation. En plus d’expliquer la puissance de l’innovation à cette époque pour assurer la survie des gens, elle a également souligné l’importance d’une innovation continue pour le bien-être des gens et d’une société. Par exemple, en plus d’avoir transmis la façon traditionnelle de tanner des peaux avec des roches, elle a également mentionné que, maintenant, elle a appris qu’il est possible d’utiliser une laveuse à pression (qui exige beaucoup moins d’efforts physiques). Selon elle, il faut non seulement apprécier les innovations du présent, mais également les innovations du passé qui ont donné le pouvoir à nos ancêtres de survivre jusqu’à la création de notre lignée.
Reconnaître ce que ces ancêtres ont dû accomplir autrefois pour survivre, c’est mieux comprendre la force qu’il leur a fallu pour être encore ici aujourd’hui.
Dans ce cadre, il y a deux citations que j’aimerais partager :
La première : Pauly a parlé d’une conversation qu’elle a eue avec son père pour savoir si c’était son idée de tailler un os en forme de hache pour l’utiliser. Il a répondu : « Si j’ai eu l’idée, c’est certain que quelqu’un·e d’autre quelque part a eu la même idée aussi. »
La deuxième : en parlant de la nature, de la vie humaine, des communautés, des sociétés et des pays, Pauly a dit : « Le monde est toujours en train de changer, c’est précisément cela qui est la seule vérité universelle. »
Leçon no 3 : les animaux ont créé les premiers sentiers
Un jour, notre guide de Howl, Warren Lake, nous a guidé·e·s dans notre première randonnée dans le parc national Kluane, vers le sommet de Thechàl Dhâl. Après avoir pris du temps pour nous éduquer sur les éléments nécessaires pour se préparer à être dans une étendue sauvage (vérifier la météo, consulter les avertissements dans la région, amener une bouteille d’eau et de la bouffe, etc.), on était sur place, prêt·e·s à embarquer. N’oubliez pas qu’on était au Yukon pour apprendre de la terre (parmi d’autres raisons), donc lors de la randonnée, on s’est arrêté·e·s à plusieurs reprises à cette fin.
Nous avons vu des arbres tombés, et Warren a expliqué que le sol au Yukon n’est pas très profond. Par conséquent, les racines des arbres poussent en largeur plutôt que de s’enfoncer vers le bas. C’est l’une des raisons pour lesquelles les changements climatiques représentent un grand risque pour les forêts du territoire : avec l’érosion et la fonte des glaciers, le sol peut être emporté, laissant derrière lui une argile stérile où peu pousse, voire rien.
Nous avons aussi observé des arbres présentant d’étranges déformations — de grosses protubérances sur leur écorce. Warren a expliqué qu’il s’agissait du résultat d’une infection fongique, qui inspire parfois les artistes dans leurs créations architecturales ou sculpturales.
Au fil de ce show and tell en pleine nature, Warren a mentionné, presque en passant, que les premiers sentiers ont été façonnés… par des animaux. Là, j’ai dû lui demander de répéter. J’ai toujours cru que les sentiers étaient créés par les humains, mais, en réalité, non. D’abord, les animaux ont tracé des chemins en choisissant les passages les moins encombrés dans la forêt. Ensuite, les peuples autochtones ont remarqué ces sentiers et ont choisi de les suivre. Enfin, les allochtones et les institutions (comme Parcs Canada) les ont élargis et formalisés. N’est-ce pas incroyable?

Les participant.e.s à Howl se tiennent sur un sentier et admirent un paysage du Yukon
C’est la première fois que j’ai vu un exemple si simple de l’application de la loi naturelle. Souvent, les sociétés coloniales préfèrent dominer la nature, ce qui veut dire qu’on essaie de faire ce qu’on veut, peu importe l’ordre naturel des choses et les écosystèmes en place. Les sociétés autochtones, en revanche, ont tendance à émuler la nature et à apprendre d’elle. Cependant, voici un exemple puissant de la loi naturelle en action : les sentiers. L’élément vital de presque tous les passe-temps canadiens. Ils viennent des animaux. On suit les pas des animaux pour savoir comment être dans ces espaces sauvages.
Il y a quelques mois, j’ai eu le plaisir d’écouter Chloe Dragon Smith, une femme dénésolinée des Territoires du Nord-Ouest, qui a parlé de la loi naturelle lors d’un discours liminaire au Symposium canadien sur les espaces verts inclusifs. Elle a montré une visualisation que je vais essayer de répliquer ici :

Dans cette visualisation, on observe les changements constants de la nature — comme l’a souligné Pauly, la seule vérité permanente est celle du changement continu. Les sociétés autochtones, elles, déploient des efforts pour suivre ces transformations et s’y adapter à leur manière, afin de continuer à vivre en harmonie avec la nature. En comparaison, la société coloniale cherche à maintenir une trajectoire linéaire, perdant ainsi son harmonie avec la nature lorsque celle-ci évolue, sauf lorsqu’elle est contrainte de s’adapter.
Cette opposition révèle que l’harmonie avec la nature ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans la capacité à évoluer avec lui, en s’inspirant des leçons que nous offrent la nature et les animaux.
Leçon no 4 : le mont Logan n’a pas de nom autochtone
Les langues portent souvent les valeurs de leurs locuteur·rice·s et c’est absolument le cas pour le tutchone du Sud, la principale langue autochtone de la région où on était. La langue tutchone du Sud est plus souvent appelée Dän'ke qui signifie « notre façon » ou Dän k'e kwänje qui signifie « notre façon de parler ». Au début des années 1950, près de 20 000 personnes parlaient le tutchone du Sud. Depuis, ce nombre a chuté drastiquement pour atteindre seulement quelques centaines. En 2004, on comptait 404 personnes pour qui le tutchone du Sud était la langue maternelle, et 645 personnes au total qui en avaient une certaine connaissance.
Un exemple classique pour illustrer la différence entre les perspectives promulguées par la langue tutchone du Sud versus celles promulguées par la langue anglaise (dans ce cas) se trouve dans la manière de nommer les lieux. Les locuteur·rice·s du tutchone du Sud — aujourd’hui représenté·e·s notamment par les membres de la Première Nation Kluane et des Premières Nations Champagne et Aishihik (PNCA) — avaient pour habitude de donner aux lieux des noms qui servaient à les localiser ou à les décrire. Comme l’a expliqué l’Aîné Ron Chambers au Centre culturel Da Kų, le nom d’un endroit pouvait indiquer où trouver de la nourriture ou, parfois, comment s’y rendre s’il servait de point de repère.
Par exemple, le mont Sheep (en anglais) est connu sous le nom de Thechàl Dhâl par les locuteur·rice·s du tutchone du Sud, ce qui signifie « la montagne du grattoir à peaux », en référence au thechàl, un grattoir en pierre plate utilisé pour préparer les peaux d’animaux. Pour les personnes autochtones, c’était un lieu où trouver du thechàl, tandis que pour les personnes allochtones, c’était un lieu où chasser des mouflons de Dall. Or, comme l’a expliqué Pauly, les mouflons ne vivaient pas uniquement sur cette montagne; ainsi, pour les personnes Kluane, ce nom n’avait pas vraiment de sens.
Un autre exemple est celui du village de Haines Junction (en anglais), appelé Dakwäkäda en tutchone du Sud, ce qui signifie « l’endroit du grand grenier ». La communauté de Haines Junction a vu le jour après la construction de l’autoroute de l’Alaska et de la route de Haines, entre 1942 et 1943. Avec l’installation d’entreprises et de bâtiments, un village s’est progressivement développé au carrefour de ces deux routes. Le nom anglais, quant à lui, provient de cette histoire : il rend hommage à Francina E. Haines, présidente du comité qui a levé des fonds pour la construction d’une église à Haines, en Alaska. Bien avant cela, dans les temps anciens (kwädąy), Dakwäkäda se trouvait déjà à l’intersection de divers sentiers. Les familles locales y entreposaient leurs biens, notamment la nourriture récoltée ou chassée dans la région.
Les différences dans les habitudes de nomenclature ne révèlent pas seulement une divergence amusante de perspectives, mais surtout une différence de valeurs. Dès leur arrivée sur les territoires que l’on appelle aujourd’hui le Yukon, les personnes allochtones avaient pour objectif de tirer profit de la terre et de dominer la nature. Cela se reflète clairement dans les noms qu’elles ont choisis. Chaque fois qu’un lieu a été nommé après un être humain, cela signifiait que la valeur de ce lieu était en lien avec la personne connexe — ce lieu n’avait pas de valeur toute seule, mais en lien avec « son parrain ou sa marraine ». Chaque fois qu’un lieu a été nommé après une ressource, c’était pour marquer son exploitation. Chaque fois qu’un lieu a reçu le nom d’un endroit en Europe, c’était dans le but d’effacer son identité unique et d’imposer un sentiment de familiarité.
Les différences dans les noms reflétaient les visions du monde et les façons d’être propres à chaque groupe socioculturel. Malheureusement, à travers la colonisation, les personnes allochtones n’étaient pas prêtes à respecter l’existence de plusieurs visions du monde. Elles étaient coincées dans la perspective qu’il n’existe qu’une bonne façon de faire les choses et que toutes les autres manières sont inférieures. Leur vision du monde exigeait le besoin de tout dominer et on voit ceci dans les noms donnés. Lorsque les noms ne sont pas inspirés par le lieu lui-même, on trouve moins de besoins d’apprendre de la terre/de la nature.
Avec les traités modernes et la revitalisation culturelle en cours au Yukon, des efforts sont déployés pour redonner aux lieux leurs noms originaux en tutchone du Sud. Toutefois, un fait curieux est apparu dans le cadre de ces démarches : le mont Logan, le point culminant du Canada et le deuxième plus haut sommet de toute l’Amérique du Nord, n’a pas de nom traditionnel. En parlant avec Pauly, elle a raconté avoir posé la question à sa mère, qui lui avait répondu : « Il n’y a rien là-bas, pourquoi lui donnerait-on un nom? » Une histoire similaire est ressortie lors d’une conversation avec Ron. Alors qu’il travaillait avec Parcs Canada, il avait reçu pour tâche de gravir la montagne afin de formuler des recommandations pour les personnes souhaitant l’escalader comme loisir. De retour, lorsqu’il en a parlé à ses Aîné·e·s, ceux et celles-ci lui ont demandé : « Y as-tu trouvé des mouflons? » — « Non. » — « Des orignaux? » — « Non. » — « Des minéraux? » — « Non. » — « Alors, pourquoi la visite? »
Leur conclusion était simple : si la montagne n’apportait ni nourriture ni chemin, elle n’avait pas besoin de nom. Pourquoi nommer le vide? Dans la langue du tutchone du Sud, nommer, c’est reconnaître une relation, c’est inscrire la mémoire d’un lien vivant entre la terre et ses habitant·e·s. Le mont Logan, dans son silence anonyme, rappelle que tout n’a pas besoin d’être possédé, classé ou désigné pour exister. Certaines choses peuvent simplement être.
Dans la perspective coloniale, la valeur de la montagne réside dans sa hauteur : plus elle est haute, plus elle mérite d’être remarquée, cartographiée et nommée. Le mont Logan a été nommé en 1890 par Israel Cook Russell en l’honneur de William Edmond Logan, géologue canadien et fondateur de la Commission géologique du Canada. Un fait amusant est qu’après le décès du Premier ministre Pierre Elliott Trudeau en 2000, son successeur par intérim, Jean Chrétien, a proposé de rebaptiser la montagne à son nom.
Cela illustre bien la différence entre une approche autochtone, qui attribue un nom en fonction de la relation au lieu et de ce qu’il procure, et une approche coloniale, qui tend à nommer même l’inutile, simplement pour marquer sa domination symbolique.
Leçon no 5 : la réconciliation signifie avancer ensemble
Vers la fin de la semaine avec Howl, nous avons eu l’occasion de visiter le Centre culturel Da Kų. Lors de notre passage, nous avons eu la chance de croiser l’artiste Jai Reid, qui fait partie de la PNCA. Il était en train de restaurer une rame taillée en bois. En remarquant notre curiosité, il a invité notre groupe entier de 20 personnes dans son atelier et il nous a montré son art. Il a expliqué que la rame qu’il restaurait appartenait à un membre de la communauté qui a perdu son père. Ce membre de la communauté a été déchiré de sa culture par les pensionnats autochtones et il faisait le travail dur de se reconnecter avec sa culture dont la rame fait partie. Son père voulait toujours terminer cette rame, mais il est mort avant de pouvoir le faire, donc son fils (le membre de la communauté) a demandé à Jai de la terminer.

L'artiste Jai Reid démontre sa pratique aux membres de Howl au Centre culturel Da Ku
Jai a expliqué que, pour lui, la réconciliation consiste à revendiquer ce qui a été perdu. À titre d’exemple, son art lui a donné le désir et la force d’explorer la question de l’identité et le mariage de plusieurs identités. Issu de deux nations autochtones, il a récemment commencé à expérimenter dans son art pour fusionner les styles distincts de ses deux lignées. Par ce travail, il revendique ce qui lui revient de droit : sa personne, son histoire, son être entier.

Deux rames en bois sculptées sur un établi avec des motifs peints à la main restaurés par l'artiste Jai Reid
Par la suite, nous avons parlé avec l’Aîné Ron, qui a fait part des conséquences des pensionnats autochtones sur sa famille. Il a raconté comment il devait traverser de vastes étendues pour s’y rendre, le fait qu’il était enfermé toute l’année à l’école, sans avoir le droit de sortir même pour un après-midi, ainsi que la perte de sa langue et de sa culture. Or, il a également parlé de ce qui a suivi. Il a évoqué son activisme pour mettre fin à ces écoles et le processus de guérison à travers la connexion avec d’autres nations et personnes autochtones partout au Canada. Il a mentionné que, même au Québec, lorsqu’il y rencontrait des nations et des personnes autochtones, dès qu’il évoquait les pensionnats, elles avaient tant de choses à transmettre et à raconter.
Ron a parlé de la perte de sa mère et du fait que ses derniers mots étaient une chanson que les deux chantaient ensemble pendant son enfance, et dont il se souvenait encore. À travers ce tissage d’histoires et d’expériences vécues comme savoir, il a partagé une réflexion qui m’est restée : « Parfois, les allié·e·s s’approprient l’expérience des pensionnats et peuvent être plus durs que les survivant·e·s. L’état d’esprit des survivant·e·s consiste à rassembler les gens et à avancer de manière positive. Des réparations, pas des punitions. »
Ron a répété des propos similaires à ceux de Jai. Pour lui, la réconciliation consiste à retrouver ce que l’on peut, sachant que tout ce qui a été perdu ne peut pas toujours être retrouvé. Il a ajouté que la réconciliation, c’est aussi être ensemble et avancer ensemble. Il ne s’agit pas d’utiliser le passé pour ériger des barrières entre les personnes, mais de progresser ensemble dans la vérité et l’action. Ce n’est pas un processus passif, ni seulement enraciné dans la colère ou la haine. Au contraire, la réconciliation fait appel à l’amour, au courage de reconnaître et de célébrer les personnes que la société a invisibilisées, et à la force de réinventer ensemble un avenir commun.
Ceci me fait penser à une question que notre groupe a posée à l’Aîné Harold Johnson de Kwaday Dan Kenji (Long Ago Peoples Place) au sujet du système de clans au Yukon.
Question : « Qu’advient-il lorsqu’une personne autochtone yukonnaise se marie avec une personne allochtone? »
Harold : « La personne allochtone sera adoptée par le clan et baptisée avec un nom du clan. Ceci n’est pas automatique, car ça dépend des actions de cette personne dans la communauté. Cela prend du temps, mais une fois acceptée, elle porte l’identité du clan pour le reste de sa vie. »
N’est-ce pas une belle métaphore de notre rôle dans la réconciliation? Que l’on soit reconnu·e·s par les communautés autochtones que nous côtoyons, non pour nos paroles, mais pour nos actions.
Pour terminer…
Ceci n’est qu’un échantillon des leçons que le Yukon m’a offertes. Je continue à en décortiquer chaque son, chaque image, chaque rencontre, en me demandant sans cesse comment ces enseignements résonneront dans mon travail à l’Institut Tamarack et dans ma vie personnelle. Quel écho le Yukon laissera-t-il dans les communautés que je soutiens? Quelles graines semées ici germeront là où je vis et travaille?
Un immense merci à Howl pour cette aventure, et une gratitude infinie au Yukon, ce territoire plus grand que nature.
Ahou… houuu… houuuuuuu1!
1 un hurlement de loup – un geste symbolisant The Howl Experience